QUATRE A 4
de Michel Garneau
Mise en scène : Marjorie Nakache
Histoires de femmes, histoires de famille, de violence, de sexe, de passion, d’amour, d’ennui, histoires de mères, histoires de filles, de petites filles, d’arrière-petite fille. Des histoires comme on en connaît tous, qui nous ont remués, qui nous troublent encore, qui nous font éclater en sanglots, qui ravivent la colère, la peur, la nostalgie, la curiosité, le chagrin de la perte.
La pièce de Michel Garneau, poète et dramaturge québécois, place le spectateur au cœur de nos émotions intimes. Les visages de notre fille, de notre mère et de notre grand-mère s’approchent avec les souvenirs qui leur sont liés, avec les paroles qu’on n’a pas dites, ou trop souvent répétées, avec l’amour qu’on a donné, refusé, reçu, ignoré, mendié. Une image de notre histoire est sur scène.
 Devant l’arbre de la lignée qui écarte ses branches en fond de scène, quatre femmes, quatre générations communiquent sans se parler, se parlent sans se voir, s’appellent, se répondent. Et le même mot se redit et les relie : Maman.
Devant l’arbre de la lignée qui écarte ses branches en fond de scène, quatre femmes, quatre générations communiquent sans se parler, se parlent sans se voir, s’appellent, se répondent. Et le même mot se redit et les relie : Maman.
Avant-scène côté jardin, Anouk – Jamila Aznague - saute sur son lit ! Seule dans sa chambre, elle crie sa joie d’être libre, d’avoir jeté son copain qui ne voulait pas travailler. Mais la liberté a un goût de solitude. Qu’en fera-t-elle ? Elle pense à sa mère : « Maman je m’ennuie d’un niaiseux. »
Derrière un rideau de tulle noir, les trois autres femmes. La mère – Marjorie Nakache - côté cour, près d’un fauteuil sous la lampe. Elle fait ses carreaux. Elle s’ennuie. Elle a épousé un commis voyageur qui rentre une fois par mois. C’est la résignée, dont les rêves ont été brisés « en confettis ». Elle n’en a plus. Elle attend. Elle fait le ménage.
La grand-mère, « mère bouteille » – Nicole Dogue – tangue au centre près d’une balançoire, une guirlande de bouteilles à portée de main, accrochées à une branche de l’arbre. Elle est la rage, mais aussi le chant. A connu le pire. Son grand-père lui a appris le sexe et l’alcool. Son mari est mort à l’asile gelé contre une fenêtre, il se prenait pour un oiseau.
A l’arrière, assise sur la plus haute branche de l’arbre, dans une robe de dentelle blanche, l’arrière-grand-mère – Agnès Debord. C’est la pieuse, « naïve comme un cantique », qui crochète pour les moutons de la crèche. Elle aimait un violoniste qui rangeait son violon sous le lit. Un jour une corde s’est cassée. Un jour il est mort. Elle n’a pas vu la mort arriver et vit encore dans son amour de femme. Et ces vies de femmes se racontent, la joie d’avoir 20 ans, d’être belle, de se marier, puis la souffrance des blessures, des désillusions. Anouk, qui commence sa vie, ne veut plus les entendre. Elle veut voyager léger, ne pas encombrer ses valises du poids des vies passées, du poids de l’ennui de sa mère, de la déchéance de la grand-mère, de l’amour figé de l’aïeule. La pièce se finit sur le bruit d’un train, le départ d’une vie à inventer.
Et ces vies de femmes se racontent, la joie d’avoir 20 ans, d’être belle, de se marier, puis la souffrance des blessures, des désillusions. Anouk, qui commence sa vie, ne veut plus les entendre. Elle veut voyager léger, ne pas encombrer ses valises du poids des vies passées, du poids de l’ennui de sa mère, de la déchéance de la grand-mère, de l’amour figé de l’aïeule. La pièce se finit sur le bruit d’un train, le départ d’une vie à inventer.
La réalisation de Marjorie Nakache, accompagnée de Xavier Marchesci pour la dramaturgie - est une vraie réussite. Un travail très précis sur les éclairages – félicitations à Lauriano de la Rosa qui les a conçus et à Hervé Janlin qui les a rendus possibles à Coye-la-forêt – permet aux femmes de la lignée d’apparaître dans une lumière ciblée ou de disparaître dans l’ombre. Tantôt elles sont de chair avec leurs cohortes d’histoires, de conseils, de critiques, d’amour et de bienveillance, tantôt telles des pensées, elles s’évanouissent dans le noir oubli. La mise en scène fait la place belle à la poésie, comme celle de cet arbre - décor de Patricia Rabourdin - devant lequel se jouent les vies des quatre femmes et en haut duquel l’aïeule se perche dans sa candeur simplette. Comme celle de ce tulle noir, frontière tantôt opaque tantôt transparente entre la génération d’Anouk à l’avant-scène et les trois autres dans la profondeur du plateau. Le voyage dans le temps est aussi dans les costumes créés par Nadia Rémond, du jean d’Anouk à la dentelle de début de siècle, dans le choix de l’accompagnement musical, du blues des années 30, au ronronnement de la télé d’aujourd’hui en passant par Claude François.
La mise en scène fait la place belle à la poésie, comme celle de cet arbre - décor de Patricia Rabourdin - devant lequel se jouent les vies des quatre femmes et en haut duquel l’aïeule se perche dans sa candeur simplette. Comme celle de ce tulle noir, frontière tantôt opaque tantôt transparente entre la génération d’Anouk à l’avant-scène et les trois autres dans la profondeur du plateau. Le voyage dans le temps est aussi dans les costumes créés par Nadia Rémond, du jean d’Anouk à la dentelle de début de siècle, dans le choix de l’accompagnement musical, du blues des années 30, au ronronnement de la télé d’aujourd’hui en passant par Claude François.
La réussite du spectacle tient enfin au jeu des actrices, à leur forte présence. Chacune d’elles a su représenter un type de femme, une époque, un personnage auquel le spectateur s’attache. Saluons l’impétuosité de Jamila Aznague, l’ardeur qu’elle donne à la jeune fille qui veut mordre et vivre et partir, le jeu retenu et glacé de Marjorie Nakache, la mère dans son petit intérieur propret, la sensualité et le charme de Nicole Dogue, et enfin la composition d’Agnès Debord en poupée fragile hors du temps.
Et les hommes ? Il n’y en a pas ! Ceux dont on parle ne sont pas des réussites d’ailleurs, il y a celui qui meurt trop tôt, celui qui abuse de sa petite fille, celui qui ne veut pas travailler, celui qui ment et qui trompe. Oserait-on dire que la pièce est une sorte d’hommage aux femmes ? Plutôt une reconnaissance de ce que, par la maternité, les femmes transmettent. Le meilleur, comme le pire. Une reconnaissance du lien, du cordon auquel se tiennent les femmes d’une même lignée, qui est aussi bien la marque d’une solidarité qu’une entrave à la marche.
QUATRE À QUATRE De Michel Garneau
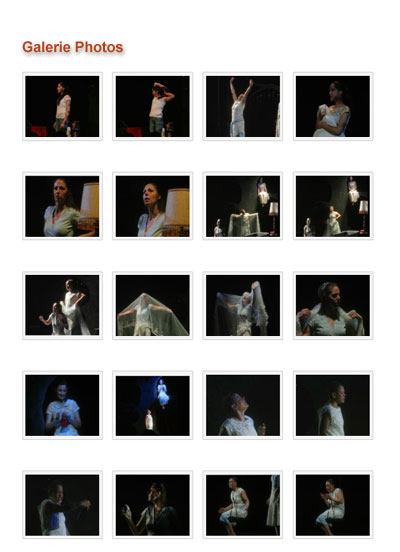
| PARTAGER |


Laisser un commentaire