LA PEUR
De Stefan Zweig.
Cie Carinae et Atelier Théâtre Actuel.
Mise en scène d'Elodie Menant.
Il est coutumier de dire que le xxe siècle s'ouvre avec la guerre de 14. Ainsi la nouvelle de Stefan Zweig, écrite en 1913 (quoique publiée en Autriche en 1920) appartient au XIXe, au temps où les femmes de la bourgeoisie aisée ne travaillaient pas, se déplaçaient en fiacre et portaient des robes longues. L'écriture aussi est datée. Il s'agit d'un très court roman dans le style où Stefan Zweig excellait, avec une analyse psychologique fine et fouillée, décrivant les tourments d'une épouse infidèle en proie au harcèlement de plus en plus pressant d'une femme qui exerce sur elle un chantage qui ne cesse d'être plus exigeant : se faisant extorquer des sommes d'argent toujours plus importantes et n'osant en parler à son mari car il lui faudrait avouer sa faute, elle entre dans une spirale infernale de peur, de mensonge et de culpabilité et s'y enfonce inexorablement.
 Une jeune metteuse en scène, Élodie Menant, s'empare de cette histoire avec sa sensibilité d'aujourd'hui et décide de l'adapter pour le théâtre. Elle explique, au cours du débat qui suit la représentation, qu'il lui a fallu entre un an et dix-huit mois à peu près pour mûrir son projet et écrire le texte, les ultimes mises au point se faisant au contact des comédiens, à partir de leurs improvisations lors des premières séances de travail.
Une jeune metteuse en scène, Élodie Menant, s'empare de cette histoire avec sa sensibilité d'aujourd'hui et décide de l'adapter pour le théâtre. Elle explique, au cours du débat qui suit la représentation, qu'il lui a fallu entre un an et dix-huit mois à peu près pour mûrir son projet et écrire le texte, les ultimes mises au point se faisant au contact des comédiens, à partir de leurs improvisations lors des premières séances de travail.
En pensant aux films d'Hitchkok, où les thèmes de la manipulation et de la culpabilité sont toujours centraux, elle décide de transposer l'histoire au milieu des années 50, dans une esthétique très nord-américaine. Il en résulte une grande cohérence dans les décors, les lumières, les musiques et les costumes. Les clins d'œil au maître du suspens sont nombreux, à commencer par le dispositif scénique qui met le spectateur en situation d'être voyeur de ce qui se passe chez les gens d'en face, comme dans "Fenêtre sur cour". Par la suite, le décor, très astucieusement, s'ouvre ou au contraire se resserre cruellement sur la malheureuse prise au piège, comme un animal affolé enfermé dans une cage ; ou bien il se met à tourner jusqu'au vertige. Quand elle arrive à desserrer l'étreinte qui l'empêche de respirer, elle s'approche de la fenêtre et c'est pour entendre les criailleries des "Oiseaux". La paire de ciseaux qu'elle a dans la main et qui évoque "Le crime était presque parfait" est en réalité une fausse piste, comme les affectionnait Alfred Hitchkock ! Les ciseaux ne seront pas l'instrument d'un meurtre.  On pense aussi à Edward Hopper : les volumes géométriques et l'éclat du soleil du matin sur les pans de murs rappellent le peintre américain.
On pense aussi à Edward Hopper : les volumes géométriques et l'éclat du soleil du matin sur les pans de murs rappellent le peintre américain.
Ce qui est spécialement réussi, c'est le contraste entre le personnage d'Irène, en robe claire et chatoyante qui virevolte avec grâce, et celui de la femme jouant le maître-chanteur, laquelle est engoncée dans une jupe serrée et un chemisier fermé jusqu'au cou, serré par une cravate, comme si elle représentait l'ordre et l'interdit, figure du surmoi freudien. Elle est comme une présence inquiétante qui ressurgit à tout moment, image obsédante de la mauvaise conscience qui ne vous lâche pas et dont il est impossible de se débarrasser, de sorte qu'on ne sait plus si elle représente un personnage réel ou une hallucination.  Il est certain que, par rapport au texte du siècle dernier, l'adaptation se devait de rééquilibrer les responsabilités entre l'homme et la femme dans la dislocation du couple. Il serait d'ailleurs plus exact d'intituler le spectacle "La peur" d'après Stefan Zweig, car aussi bien dans les grandes lignes que dans les détails, les modifications sont nombreuses par rapport au texte original. Mais c'est fait avec intelligence et finesse et les acteurs s'en emparent avec conviction. Alors que chez Stefan Zweig, le personnage masculin est bardé de bonnes intentions et que tout se termine heureusement, ici l'homme apparaît froid, préoccupé par son travail plus que par son épouse et celle-ci aura beau jeu de se défendre en disant qu'elle a été négligée. Ça commençait mal, mais ça se termine plus mal encore. À la fin, la scène est dévastée comme un champ de bataille sur lequel il ne reste que des vaincus. Chacun croyant pouvoir sauver le couple en perdition (l'une en s'enfonçant dans le mensonge, l'autre pris dans l'engrenage de la manipulation), tous les deux dans l'incapacité de parler et d'écouter, et malgré la bonne volonté dont ils essaient de faire preuve, l'un et l'autre ne font qu'agrandir jusqu'à l'infranchissable la faille qui s'était ouverte entre eux.
Il est certain que, par rapport au texte du siècle dernier, l'adaptation se devait de rééquilibrer les responsabilités entre l'homme et la femme dans la dislocation du couple. Il serait d'ailleurs plus exact d'intituler le spectacle "La peur" d'après Stefan Zweig, car aussi bien dans les grandes lignes que dans les détails, les modifications sont nombreuses par rapport au texte original. Mais c'est fait avec intelligence et finesse et les acteurs s'en emparent avec conviction. Alors que chez Stefan Zweig, le personnage masculin est bardé de bonnes intentions et que tout se termine heureusement, ici l'homme apparaît froid, préoccupé par son travail plus que par son épouse et celle-ci aura beau jeu de se défendre en disant qu'elle a été négligée. Ça commençait mal, mais ça se termine plus mal encore. À la fin, la scène est dévastée comme un champ de bataille sur lequel il ne reste que des vaincus. Chacun croyant pouvoir sauver le couple en perdition (l'une en s'enfonçant dans le mensonge, l'autre pris dans l'engrenage de la manipulation), tous les deux dans l'incapacité de parler et d'écouter, et malgré la bonne volonté dont ils essaient de faire preuve, l'un et l'autre ne font qu'agrandir jusqu'à l'infranchissable la faille qui s'était ouverte entre eux.
Galerie Photos : LA PEUR De Stefan Zweig
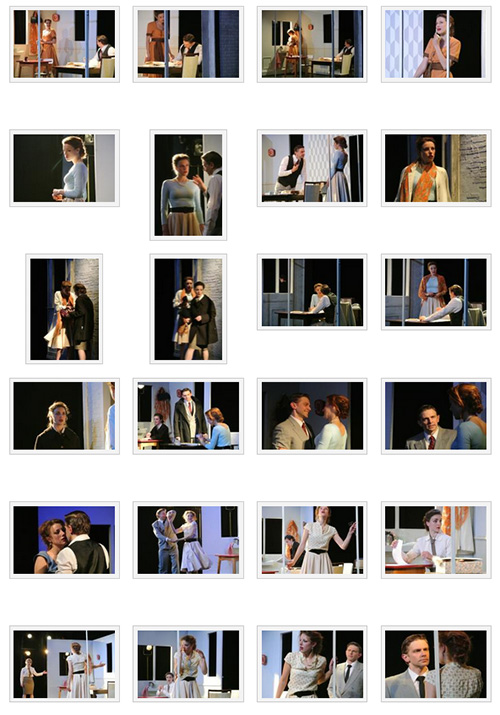
| PARTAGER |

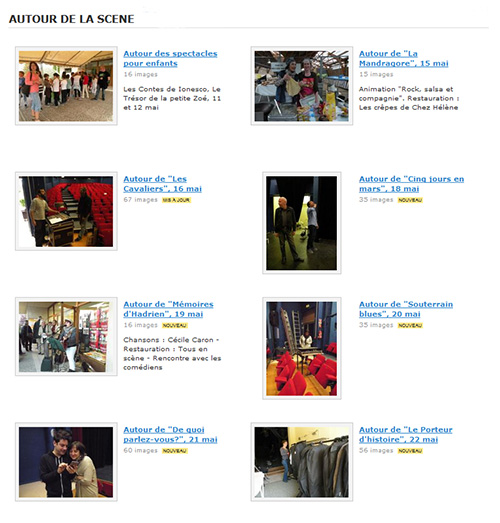

J’ai beaucoup aimé cette pièce, parce qu’elle commence dans la lumière et qu’elle finit dans le vide. Les trois acteurs sont excellents. La perversité, la manipulation, le mensonge, la peur, tout est exprimé et le spectateur vit les tensions des personnages. Bravo!