Britannicus
De Jean Racine
Compagnie Minuit44
Mise scène : Laurent Domingos
Il y a le théâtre contemporain, selon les jours, drôle, provocateur, poétique, onirique, émouvant, bouleversant parfois, en prise avec les réalités de notre temps, et les auteurs classiques – les grands tragiques de l'Antiquité, Shakespeare, Racine, Schiller… – auxquels il faut revenir régulièrement car ils sont – osons les superlatifs – immenses et éternels.
Racine, donc et plus précisément Britannicus dont l'auteur lui-même avoue que c'est celle de ses tragédies qu'il a "le plus travaillée" (seconde préface - 1676). Elle nous était proposée mardi dans une très belle mise en scène, de Laurent Domingos.
Nous assistons à la naissance politique de Néron, qui aux yeux de l'Histoire, apparaîtra comme la figure même du tyran démoniaque et tortionnaire. Pour l'instant, il est encore complètement sous l'emprise de sa mère, Agrippine, qui entretient avec lui une relation de domination incestueuse dont il essaie de se dégager mais, soumis à des influences contradictoires, il est balloté d'un côté de l'autre, vacillant, indécis, girouette ne sachant à quel conseiller se vouer. Cette faiblesse actuelle explique peut-être son excès de cruauté future. "Las de se faire aimer, il veut se faire craindre", dit de lui Agrippine dès le début de la pièce.
Car dans ce palais, nous le verrons, le sentiment le plus répandu, c'est la peur, la peur qu'il faut entretenir parce que c'est un des plus puissants instrumenst de domination. Agrippine en a parfaitement conscience qui ajoute plus loin : "Je le craindrais bientôt s'il ne me craignait plus".
L'autre marque du pouvoir est la possession de la femme, ici Junie, la bien-aimée de Britannicus. On sait que le sexe de la femme est un enjeu majeur dans les champs de bataille. À Néron qui prétend être dévoré d'une passion irrésistible, Burrhus rétorque avec fermeté :
"On n'aime point, Seigneur, si l'on ne veut aimer." Car Néron ne tombe amoureux de Junie que pour marquer sa supériorité sur Britannicus et son indépendance par rapport à Agrippine.

Toutes les idées de mise en scène sont intelligentes et significatives. J'en donnerai trois exemples.
Clair obscur et présence des comédiens dans l'ombre : Il n'y a pas d'entrées-sorties, l'ensemble des comédiens restent toujours sur scène, debout sur les côtés. Dans le palais où la peur règne en maître – la musique saturée de basses contribuant à cette inquiétude généralisée – il faut entendre ce qui se dit, mais ne pas se faire voir. On écoute derrière les portes, on se cache dans les tentures. Ainsi les personnages observent dans l'ombre, épient tout ce qui se trame, spectateurs muets mais présents, silencieux, les comédiens, tout comme les personnages ne relâchent jamais leur attention.  Tout l'action se déroule dans le clair obscur, comme si elle se déroulait la nuit, à la dérobée. Seule Junie, habillée de rouge, quand tous les autres revêtent le noir, apparaît en pleine lumière ; car Junie est en dehors des intrigues et des manigances, absolument sincère et entière dans son amour pour Britannicus, elle n'est amenée à feindre que pour essayer de le sauver. Britannicus lui-même, sans doute malgré lui impliqué dans les affaires du pouvoir du fait de sa naissance, porte une tunique noire, où figurent cependant – détail significatif – des liserés rouges : l'amour de Junie est partagé.
Tout l'action se déroule dans le clair obscur, comme si elle se déroulait la nuit, à la dérobée. Seule Junie, habillée de rouge, quand tous les autres revêtent le noir, apparaît en pleine lumière ; car Junie est en dehors des intrigues et des manigances, absolument sincère et entière dans son amour pour Britannicus, elle n'est amenée à feindre que pour essayer de le sauver. Britannicus lui-même, sans doute malgré lui impliqué dans les affaires du pouvoir du fait de sa naissance, porte une tunique noire, où figurent cependant – détail significatif – des liserés rouges : l'amour de Junie est partagé.
L'autre belle idée de mise en scène est la fusion des deux personnages de Burrhus et Narcisse,
respectivement gouverneurs de Néron et de Britannicus, joués ici par le même comédien : un détail vestimentaire et une modification dans l'attitude et la posture différencient ces deux personnages ; le simple fait de baisser les manches et de les rouler comme des poignets de force mettant en valeur des bras musclés fait voir en Burrhus un guerrier loyal, droit, vertueux, quand au contraire les manches remontées et recouvertes de paillettes sur un corps plus ondulant et maniéré laisse pressentir en Narcisse un personnage fourbe : incarnés par le même comédien, Burrhus et Narcisse sont les deux pôles, ange et démon, qui s'affrontent en tempête sous le crâne de Néron. On sait lequel l'emportera.  Enfin, il y a tout au long de la représentation, comme un fil conducteur, une très longue bande de tissu dont le personnage de Néron ne se sépare jamais : dès la scène préliminaire apparaît cette immense écharpe, instrument de torture qui bâillonne, étouffe et emprisonne Junie et qui au fur et à mesure de l'avancée de la pièce, prend des significations différentes. Elle symbolise à la fois l'objet transitionnel de l'enfant immature ("son doudou", en quelque sorte) qu'il emporte partout avec lui parce que ça le rassure ; c'est son phallus également qu'il caresse et avec lequel il joue, lorsque le comédien enveloppe son poing serré et redresse l'avant-bras en une gestuelle discrète mais sans équivoque, le fait qu'il glisse le foulard dans l'échancrure du corsage de Junie apparaissant clairement comme un viol (l'image est très forte et je l'ai ressentie comme vraiment violente, plus encore que la scène chorégraphiée du début) ; mais c'est aussi le cordon ombilical que Néron arrivera à rompre enfin pour échapper à sa mère et affirmer sa volonté propre, l'écharpe dès lors ne traînant plus par terre, mais enveloppant sa poitrine comme un habit de pouvoir et de gloire.
Enfin, il y a tout au long de la représentation, comme un fil conducteur, une très longue bande de tissu dont le personnage de Néron ne se sépare jamais : dès la scène préliminaire apparaît cette immense écharpe, instrument de torture qui bâillonne, étouffe et emprisonne Junie et qui au fur et à mesure de l'avancée de la pièce, prend des significations différentes. Elle symbolise à la fois l'objet transitionnel de l'enfant immature ("son doudou", en quelque sorte) qu'il emporte partout avec lui parce que ça le rassure ; c'est son phallus également qu'il caresse et avec lequel il joue, lorsque le comédien enveloppe son poing serré et redresse l'avant-bras en une gestuelle discrète mais sans équivoque, le fait qu'il glisse le foulard dans l'échancrure du corsage de Junie apparaissant clairement comme un viol (l'image est très forte et je l'ai ressentie comme vraiment violente, plus encore que la scène chorégraphiée du début) ; mais c'est aussi le cordon ombilical que Néron arrivera à rompre enfin pour échapper à sa mère et affirmer sa volonté propre, l'écharpe dès lors ne traînant plus par terre, mais enveloppant sa poitrine comme un habit de pouvoir et de gloire.
Cette mise en scène dépouillée, baignée d'une très belle lumière en clair obscur, composée de tableaux visuels expressifs, avec une diction extrêmement respectueuse de l'alexandrin, allie classicisme et modernité et nous invite à relire le texte de Racine en gardant en mémoire les images nouvelles qu'elle nous a proposées.
| PARTAGER |



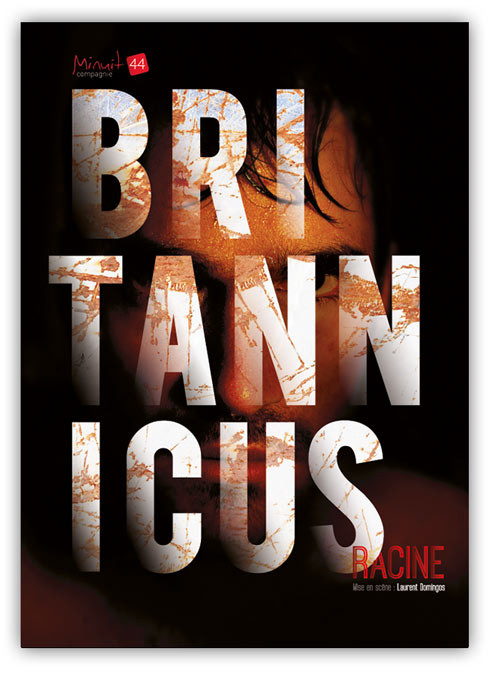
Laisser un commentaire